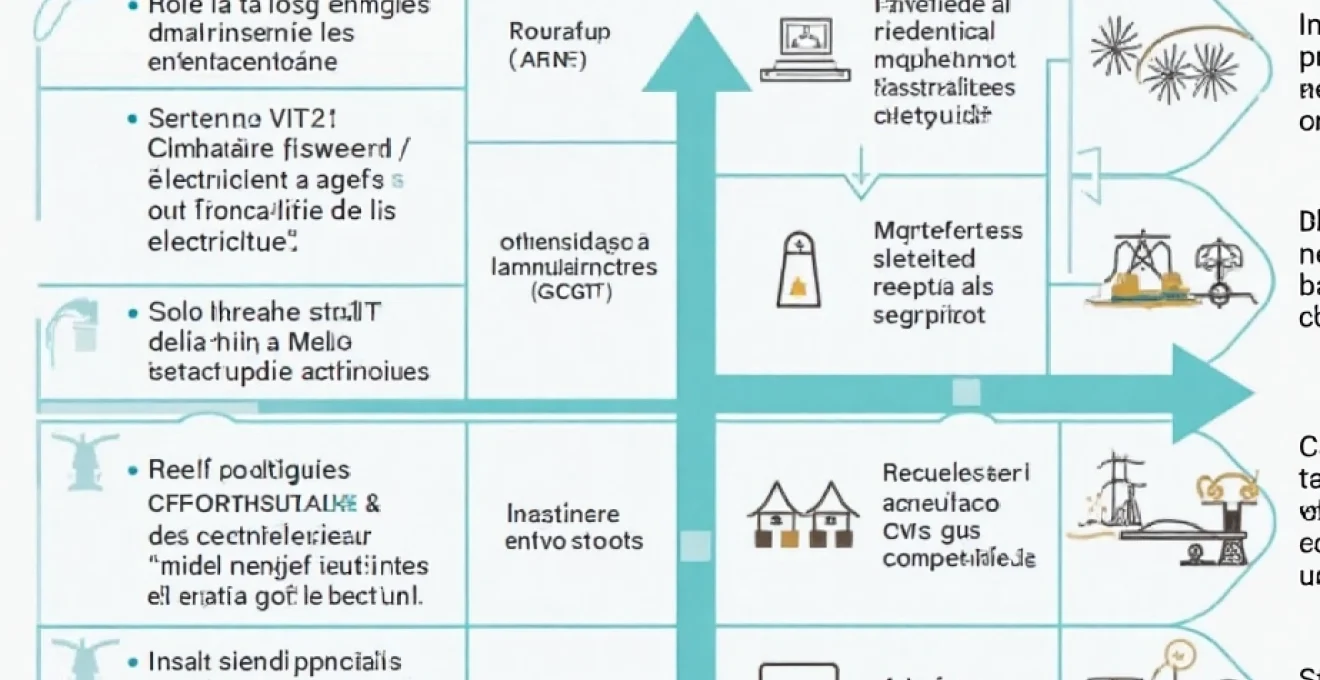
L’indexation du prix de l’électricité sur le gaz est un mécanisme complexe qui influence profondément le marché énergétique en France et en Europe. Cette interconnexion entre deux sources d’énergie distinctes soulève de nombreuses questions quant à la formation des prix et leur impact sur les consommateurs et l’industrie. Comprendre ce système est essentiel pour saisir les enjeux actuels du secteur électrique, notamment dans un contexte de transition énergétique et de volatilité des marchés.
Mécanisme de l’indexation du prix de l’électricité sur le marché du gaz
L’indexation du prix de l’électricité sur le marché du gaz est un phénomène complexe qui découle du fonctionnement du marché européen de l’électricité. Ce mécanisme, connu sous le nom de « merit order », détermine l’ordre dans lequel les différentes sources de production d’électricité sont appelées pour répondre à la demande. Les centrales les moins chères sont sollicitées en premier, suivies progressivement par les plus coûteuses jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.
Dans ce système, les centrales à gaz jouent souvent le rôle de « centrales marginales », c’est-à-dire qu’elles sont les dernières à être appelées pour équilibrer l’offre et la demande. Le prix de l’électricité sur le marché de gros est alors fixé en fonction du coût de production de ces centrales marginales. Ainsi, même si une grande partie de l’électricité produite provient de sources moins coûteuses comme le nucléaire ou les énergies renouvelables, le prix final est fortement influencé par le coût du gaz.
Cette situation crée une corrélation étroite entre les fluctuations du prix du gaz sur les marchés internationaux et le prix de l’électricité. Lorsque le prix du gaz augmente, comme ce fut le cas lors de la crise énergétique de 2022, le coût de production des centrales à gaz s’élève, entraînant une hausse généralisée des prix de l’électricité sur le marché de gros.
Rôle du système ARENH dans la fixation des prix de l’électricité
Le système ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique) joue un rôle crucial dans la fixation des prix de l’électricité en France, en complément du mécanisme d’indexation sur le gaz. Mis en place pour favoriser la concurrence sur le marché de l’électricité, l’ARENH influence significativement la structure des coûts d’approvisionnement des fournisseurs alternatifs et, par extension, les prix proposés aux consommateurs.
Fonctionnement du dispositif ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique)
L’ARENH permet aux fournisseurs alternatifs d’acheter une partie de l’électricité produite par les centrales nucléaires d’EDF à un prix régulé. Ce mécanisme vise à donner accès à l’avantage compétitif du parc nucléaire français à l’ensemble des acteurs du marché. Le prix de l’ARENH, fixé à 42 €/MWh jusqu’en 2023, est censé refléter les coûts de production du parc nucléaire historique.
Chaque année, les fournisseurs alternatifs peuvent demander à bénéficier de l’ARENH pour une partie de leur approvisionnement, dans la limite d’un plafond global fixé à 100 TWh (augmenté exceptionnellement à 120 TWh en 2022). Cette quantité est ensuite répartie entre les différents fournisseurs en fonction de leur portefeuille de clients.
Impact du plafonnement ARENH sur les coûts d’approvisionnement des fournisseurs
Le plafonnement du volume d’ARENH disponible a des conséquences importantes sur les coûts d’approvisionnement des fournisseurs. Lorsque la demande d’ARENH dépasse le plafond, comme c’est le cas depuis plusieurs années, les fournisseurs ne peuvent obtenir qu’une partie de l’électricité dont ils ont besoin à ce prix régulé. Pour le reste de leur approvisionnement, ils doivent se tourner vers le marché de gros, où les prix sont généralement plus élevés et indexés sur le gaz.
Cette situation crée une forme de double exposition pour les fournisseurs : une partie de leur approvisionnement est sécurisée à un prix fixe via l’ARENH, tandis que l’autre partie est soumise aux fluctuations du marché. En période de prix élevés sur le marché de gros, cela peut entraîner une hausse significative des coûts d’approvisionnement, qui se répercute in fine sur les factures des consommateurs.
Interactions entre ARENH et marché de gros de l’électricité
L’interaction entre l’ARENH et le marché de gros de l’électricité est complexe et influence directement la formation des prix. En théorie, l’ARENH devrait exercer une pression à la baisse sur les prix du marché en offrant une alternative moins coûteuse. Cependant, le plafonnement du volume d’ARENH limite cet effet, surtout en période de forte demande ou de prix élevés sur le marché de gros.
De plus, la différence entre le prix de l’ARENH et les prix du marché peut créer des opportunités d’arbitrage pour les fournisseurs. En période de prix bas sur le marché, certains fournisseurs peuvent être tentés de revendre leur quota d’ARENH sur le marché, tandis qu’en période de prix élevés, la demande d’ARENH augmente fortement, conduisant à un écrêtement plus important.
Influence des centrales à gaz sur la formation des prix marginaux
Les centrales à gaz jouent un rôle déterminant dans la formation des prix marginaux de l’électricité sur le marché européen. Leur flexibilité et leur capacité à répondre rapidement aux variations de la demande en font des acteurs clés du système électrique, particulièrement dans un contexte d’intégration croissante des énergies renouvelables intermittentes.
Rôle des centrales à cycle combiné gaz (CCGT) dans le merit order
Les centrales à cycle combiné gaz (CCGT) occupent une place stratégique dans le merit order du marché électrique européen. Leur position dans l’ordre d’appel des centrales les place souvent comme « producteurs marginaux », c’est-à-dire les derniers à être sollicités pour équilibrer l’offre et la demande. Cette position est due à plusieurs facteurs :
- Leur flexibilité opérationnelle, qui permet de les démarrer et de les arrêter rapidement
- Leurs coûts variables relativement élevés par rapport aux énergies renouvelables ou au nucléaire
- Leur capacité à compléter la production intermittente des énergies renouvelables
En conséquence, le coût marginal de production des CCGT détermine souvent le prix de l’électricité sur le marché spot, même si elles ne fournissent qu’une part relativement faible de la production totale.
Corrélation entre prix du gaz TTF et coûts marginaux de production électrique
La corrélation entre le prix du gaz sur le marché TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, principal indice de référence en Europe, et les coûts marginaux de production électrique est particulièrement forte. Les fluctuations du prix du gaz TTF se répercutent directement sur les coûts variables des centrales à gaz, influençant ainsi le prix de l’électricité sur le marché de gros.
Cette corrélation s’est manifestée de manière spectaculaire lors de la crise énergétique de 2022, où la flambée des prix du gaz a entraîné une hausse sans précédent des prix de l’électricité. Par exemple, lorsque le prix du gaz TTF a atteint des sommets historiques autour de 300 €/MWh en août 2022, les prix spot de l’électricité ont dépassé 1000 €/MWh sur certains marchés européens.
Impact du mécanisme ETS (emissions trading system) sur la compétitivité du gaz
Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) ajoute une dimension supplémentaire à la compétitivité des centrales à gaz. Le prix des quotas de CO2 s’ajoute au coût du combustible pour déterminer le coût marginal de production des centrales thermiques. Avec l’augmentation du prix du carbone ces dernières années, passant d’environ 5 €/tonne en 2017 à plus de 80 €/tonne en 2022, l’impact sur les coûts de production des centrales à gaz s’est considérablement accru.
Cette évolution a deux effets principaux :
- Elle renforce la compétitivité relative des sources d’énergie bas-carbone comme le nucléaire et les renouvelables
- Elle accentue la volatilité des prix de l’électricité, le coût du carbone s’ajoutant aux fluctuations du prix du gaz
Ainsi, le mécanisme ETS agit comme un amplificateur de l’indexation du prix de l’électricité sur le gaz, tout en encourageant la transition vers des sources d’énergie moins émettrices.
Effets de l’indexation gaz sur le marché français de l’électricité
L’indexation du prix de l’électricité sur le gaz a des répercussions profondes sur le marché français de l’électricité, affectant aussi bien les consommateurs résidentiels que les industriels. Cette situation crée des défis spécifiques dans un pays où la production électrique est majoritairement d’origine nucléaire et renouvelable.
Conséquences pour les consommateurs résidentiels et le tarif réglementé
Pour les consommateurs résidentiels français, l’impact de l’indexation gaz se manifeste principalement à travers l’évolution du tarif réglementé de vente (TRV) de l’électricité. Bien que ce tarif soit régulé par l’État, il n’est pas totalement déconnecté des prix du marché de gros. La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) calcule le TRV selon une méthode dite « par empilement », qui prend en compte les coûts d’approvisionnement sur le marché de gros.
Ainsi, lors de la crise énergétique de 2022, le gouvernement français a dû mettre en place un « bouclier tarifaire » pour limiter la hausse du TRV à 4% en 2022, puis à 15% en 2023, alors que l’application stricte de la formule aurait conduit à des augmentations beaucoup plus importantes. Cette intervention illustre les tensions entre la volonté de protéger les consommateurs et la nécessité de refléter les réalités du marché.
Enjeux pour les industriels électro-intensifs face à la volatilité des prix
Les industriels électro-intensifs sont particulièrement exposés aux effets de l’indexation gaz. Ces entreprises, pour lesquelles l’électricité représente une part importante des coûts de production, sont directement impactées par la volatilité des prix sur le marché de gros. La compétitivité de secteurs entiers de l’industrie française (sidérurgie, chimie, papeterie, etc.) peut ainsi être remise en question lors de périodes de prix élevés.
Pour atténuer ces risques, plusieurs mécanismes ont été mis en place :
- L’accès prioritaire à l’ARENH pour les industries électro-intensives
- Des contrats long terme avec EDF, permettant de sécuriser une partie de l’approvisionnement
- Des mesures de compensation des coûts indirects du système ETS
Malgré ces dispositifs, la question de la compétitivité énergétique reste un enjeu majeur pour l’industrie française face à la concurrence internationale.
Débat sur la réforme du marché européen de l’électricité (ARENH 2.0)
Face aux limites du système actuel, mises en lumière par la crise énergétique, un débat s’est engagé sur la nécessité de réformer le marché européen de l’électricité. En France, les discussions se concentrent notamment sur l’évolution du dispositif ARENH, parfois surnommé « ARENH 2.0 ».
Les principales pistes de réflexion incluent :
- Une révision du prix de l’ARENH pour mieux refléter les coûts réels de production nucléaire
- Une augmentation du volume d’ARENH disponible pour limiter l’exposition au marché de gros
- La mise en place de contrats à long terme pour une partie de la production nucléaire
Ces propositions visent à réduire l’impact de l’indexation gaz sur les prix français de l’électricité, tout en préservant les incitations à l’investissement dans de nouvelles capacités de production bas-carbone.
Perspectives d’évolution du système d’indexation électricité-gaz
L’évolution du système d’indexation électricité-gaz est au cœur des réflexions sur l’avenir du marché énergétique européen. Les crises récentes ont mis en lumière les limites du modèle actuel et la nécessité d’adapter les mécanismes de formation des prix aux nouveaux enjeux de la transition énergétique.
Projets de découplage partiel des prix de l’électricité et du gaz
Plusieurs projets de réforme visent à réduire la dépendance des prix de l’électricité aux fluctuations du marché du gaz. L’une des pistes explorées est la mise en place d’un système de contrats pour différence (CFD) pour les nouvelles capacités de production bas-carbone. Ce mécanisme garantirait un prix fixe aux producteurs tout en protégeant les consommateurs contre les hausses excessives.
Une autre approche consiste à segmenter le marché de l’électricité en fonction des technologies de production
Une autre approche consiste à segmenter le marché de l’électricité en fonction des technologies de production, avec des prix différenciés pour l’électricité nucléaire, renouvelable et thermique. Cette segmentation permettrait de mieux refléter les coûts réels de chaque technologie et de réduire l’impact des fluctuations du prix du gaz sur l’ensemble du marché.
Rôle potentiel des énergies renouvelables dans la formation des prix
L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique européen pourrait significativement modifier la dynamique de formation des prix. Contrairement aux centrales à gaz, les installations solaires et éoliennes ont des coûts marginaux quasi nuls une fois construites. Leur intégration massive dans le réseau pourrait donc exercer une pression à la baisse sur les prix de gros de l’électricité.
Cependant, l’intermittence de ces sources d’énergie pose de nouveaux défis pour l’équilibrage du réseau. Des mécanismes de flexibilité, tels que le stockage d’énergie ou la gestion de la demande, devront être développés pour garantir la stabilité du système. Ces solutions pourraient elles-mêmes influencer la formation des prix, en introduisant de nouveaux acteurs et de nouvelles dynamiques sur le marché.
Par ailleurs, le développement des contrats d’achat d’électricité (PPA) pour les énergies renouvelables offre une alternative au marché spot pour la valorisation de cette production. Ces contrats à long terme, conclus directement entre producteurs et consommateurs, pourraient contribuer à stabiliser une partie des prix de l’électricité, indépendamment des fluctuations du marché du gaz.
Scénarios d’évolution du mix énergétique français à l’horizon 2030-2050
L’évolution du mix énergétique français dans les décennies à venir aura un impact déterminant sur le système de formation des prix de l’électricité. Plusieurs scénarios sont envisagés, chacun avec des implications différentes pour l’indexation électricité-gaz :
- Scénario de continuité nucléaire : Ce scénario prévoit le maintien d’une part importante du nucléaire (50% ou plus) dans le mix électrique, complété par une montée en puissance des énergies renouvelables. Il pourrait conduire à une réduction de la dépendance au gaz et donc à un affaiblissement de l’indexation.
- Scénario de transition accélérée vers les renouvelables : Une forte augmentation de la part des énergies renouvelables (jusqu’à 70-80% du mix) pourrait modifier radicalement la logique de formation des prix, avec des périodes de prix très bas lors des pics de production renouvelable.
Dans tous les cas, la question du stockage de l’énergie et de la flexibilité du réseau sera cruciale. Le développement de technologies comme l’hydrogène vert ou les batteries à grande échelle pourrait introduire de nouveaux paramètres dans la formation des prix de l’électricité, potentiellement en réduisant le rôle du gaz comme source de flexibilité.
Enfin, l’évolution du cadre réglementaire européen jouera un rôle clé. La mise en place d’un prix du carbone plus élevé et plus stable à travers le renforcement du système ETS pourrait accélérer la sortie du gaz et donc modifier en profondeur le mécanisme d’indexation actuel.
En conclusion, si l’indexation du prix de l’électricité sur le gaz reste une réalité à court terme, les évolutions technologiques, réglementaires et structurelles du marché de l’énergie laissent entrevoir des changements significatifs dans les années à venir. La transition vers un système énergétique plus durable et moins dépendant des énergies fossiles pourrait conduire à l’émergence de nouveaux mécanismes de formation des prix, mieux adaptés aux enjeux de la transition énergétique et à la protection des consommateurs contre la volatilité excessive des marchés.